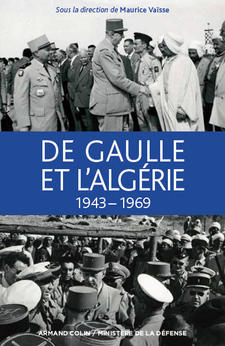Et le doute qui entoure les modalités du cessez-le-feu et ses suites en Algérie est si profond qu’il va jusqu’à troubler la figure du Libérateur de 1944-1945 qui, lui, fait de plus en plus l’unanimité. Alors que la précocité des mesures d’exclusion prises à l’égard des étrangers, juifs ou « dissidents » de tous bords, fait s’estomper la division originaire autour de Vichy, les questions sur les lendemains d’Évian ne cessent au contraire de se multiplier. Qu’il s’agisse de la panique des Européens, terrorisés par les enlèvements FLN et les violences OAS, ou de leur exil immédiat qui, aussi imprévu que massif, va aussitôt vider les accords d’Évian de toute substance.
Ou pire encore, que cet effondrement de la population européenne n’ait finalement été que le prélude au massacre des harkis en Algérie. Massacre qui va justifier l’arrivée en France, continue jusqu’en 1969 mais tout aussi imprévue, de supplétifs aux statuts variés.
Sans oublier l’immigration algérienne ordinaire qui, restée libre jusqu’en 1973, s’est nourrie des désordres et des déceptions des premières années de l’indépendance. Tous ces éléments, parfois contradictoires, ont transporté en France une guerre des mémoires que le temps n’a pas fini d’apaiser, tant les souvenirs y sont intriqués.
Tout avait commencé avec la République de 1848, République constitutionnelle dont la brève existence n’a pas su, selon les mots de Tocqueville, faire transiter la légitimité française du droit de conquête hérité des monarchies, au droit de justice, revendiqué par la République. Alors, comment dire ce siècle de présence française outre-Méditerranée ? Et où faut-il situer les débuts du processus délétère ?
Par exemple, sans avoir encore fini d’explorer toutes les archives qui vont nourrir sa thèse, Roger Benmebarek laisse entendre que les évènements de mai 1945 dans le Constantinois seraient plus liés aux débuts d’une guerre froide que de Gaulle voyait venir, ce qui le faisait mesurer mieux que personne les limites de son fameux « pouvoir personnel ».
La première limite étant évidemment la nature « provisoire » de son gouvernement qui, ayant passé outre au veto du parti radical pour donner le droit de vote aux femmes, ne s’est pas cru autorisé à l’élargir aux Musulmans d’Algérie, dotés depuis l’ordonnance de Catroux de la citoyenneté civile mais non politique, à la différence des Juifs, pour qui le décret Crémieux aboli par Vichy, avait été rétabli. Il faut donc savoir gré à ce De Gaulle et l’Algérie d’avoir commencé aux débuts, i.e. en mai 1943, lorsque le président du Comité français de libération nationale (CFLN), arrivé seul à Alger, sent que sa première urgence est d’asseoir son pouvoir au-dessus des factions qui s’agitent et espèrent à temps et contre-temps.
Et l’enjeu va très au-delà d’une éventuelle « jalousie » à l’égard d’une armée française reconstruite et rééquipée à l’américaine, grâce à la soumission d’un général Giraud qui, très ignorant du poids de la Résistance en France, peine à s’affranchir des postulats idéologiques de Vichy. L’enjeu est évidemment le rétablissement d’un État républicain sur les deux bords de la Méditerranée, un État capable de décider et de trancher sans plier devant les intérêts, les privilèges et autres prébendes coloniales, si anciens qu’on ne les voit plus. Et cela en dépit de la forte mobilisation des Européens chantant l’année suivante le célèbre « C’est nous les Africains ». Européens dont la proportion d’enrôlement volontaire fut supérieure à celle des Musulmans, ce que de Gaulle ne manquera pas de rappeler à Ferhat Abbas. Il est seulement dommage que la séquence 1946-1947 n’ait pas été aussi bien éclairée, car c’est là que réside la source de cette lucidité impuissante qui fera la tragédie propre au Général. Peu importe si le Général de 1958 était ou non partisan de l’indépendance (et Georgette Elgey rapporte sur ce point une moisson de témoignages contraires), l’important est de réaliser à quel point il a aussitôt évalué les difficultés qu’il est déjà décidé à affronter, supporter et surtout « assumer » sans broncher ni s’excuser. Car il y aura des ratés et des déceptions, sans compter les accusations de « trahison » et les menaces d’attentats. Mais, lucide, le Général mit sa « gloire » au service d’une indépendance qui n’aura jamais fini d’être conquise et reconquise, tant les rapports de la France et de l’Algérie, jamais mis au clair, étaient humainement complexes…
Car si les efforts – et les escamotages – du Front populaire sont connus, on connaît moins ceux de l’année 1946 où, dès janvier, de Gaulle, élu à l’unanimité chef du gouvernement par l’Assemblée constituante, est poussé à la démission après s’être vu refuser par François de Menthon, président de la commission des lois, le droit d’être auditionné au sujet de la Constitution de la IVe République appelée de ses vœux le 14 juillet 1943 sur le forum d’Alger ! Et toute l’année 1946, de Bayeux à Épinal, devant les foules ou lors de simples communiqués à l’AFP, le Général cherche à faire entendre aux chefs du tripartisme, qu’aux lendemains de la victoire, l’évolution du monde exige plus que jamais « un État qui en soit un », en particulier au regard de l’Union française, encore toute à bâtir. Sans succès. Jusqu’à cet été 1947, où la guerre froide et le renvoi des communistes par Paul Ramadier obligent le président du Conseil en quête de majorité à solliciter le soutien de Colombey pour l’élaboration du Statut de l’Algérie qui, avec l’aide d’un de Gaulle acceptant de revenir sur certaines mesures de l’ordonnance de 1944, sera péniblement voté au mois d’août par la première Assemblée législative de la IVe République.
Mais en l’absence des élus des deux collèges et sans toucher au vieux cadre constitutionnel hérité de 1848, à savoir la division en trois départements et la surreprésentation des Européens, dix fois moins nombreux que les Musulmans.
Telles sont les origines d’un drame jamais évalué dans son ensemble où la commémoration de la fin est aussi difficile à dire que la remémoration des débuts. Telles sont les sources du drame de ces 134 années de « souveraineté française » dira de Gaulle, toujours intransigeant sur ce point – de souveraineté « algérienne » répondront les Algériens du FLN, parti « révolutionnaire » qui se veut tout aussi ferme dans sa construction d’une légendaire et héroïque insoumission, plus efficace pour soulever les maquis et enflammer les congrès de Tripoli, que pour nourrir la table des négociations secrètes, en Suisse ou en France, là où le talent des négociateurs français – Louis Joxe, Bruno de Leusse, Jean de Broglie et Robert Buron – finira par impressionner et s’imposer pour obliger à la signature.
Car de Gaulle n’est pas seul mais entouré d’une pléiade d’homme que les archives font revivre – Michel Debré, Louis Joxe, René Brouillet, Bernard Tricot, Paul Delouvrier et d’autres – tous aussi lucides sur les risques de perdre leur honneur dans cette tragédie, tous aussi silencieux sur les hésitations et les douleurs du chef de l’État, tous émus de voir ce vieil homme, tendu vers la conclusion d’un drame qui risque d’entraîner la France dans le gouffre de la guerre civile.
Si les accords d’Évian ont ramené en métropole un contingent soulagé d’être libéré d’un conflit dont les termes lui échappaient de plus en plus, il n’en a pas été de même en Algérie où le nouveau gouvernement, toujours aux prises avec de graves divisions internes, trouvera sa meilleure unité dans le fait de continuer la lutte contre la France, par les moyens diplomatiques où le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) était passé maître.
Ainsi s’explique l’acharnement à revenir au plus vite sur les concessions d’Évian, afin de récupérer la pleine souveraineté culturelle et économique en Algérie comme au Sahara, où les richesses pétrolières et les « mystères » stratégiques affolent les esprits. En clair, les gouvernements successifs de l’Algérie, celui de Ben Bella comme celui de Boumedienne resteront fidèles à la philosophie du GPRA et au programme de Tripoli refusant non seulement l’héritage du passé colonial au profit de l’arabisation scolaire et administrative mais aussi toute politique de coopération entre une puissance libérale dotée de compétences techniques et un État socialiste en construction, plutôt décidé à chercher son inspiration du côté de Mao ou des nouveaux États socialistes ou sud-américains. Ce qui accroîtra d’autant les difficultés de De Gaulle, de plus en plus réduit dans ses discours célébrant le retour à la paix, à des paroles d’apparence où les nobles propos ne seront plus prononcés qu’à destination du public français, afin de le convaincre de la validité et de la noblesse du nouveau « modèle » de relations établies entre l’ancienne puissance impériale et les nouveaux pays fraîchement issus de la décolonisation.
Propos qui n’illusionnaient guère les fonctionnaires français qui, au courant des réalités, étaient plutôt interloqués par « l’indulgence » officielle d’un Général, pourtant fort lucide en privé…
La guerre d’Algérie venait de si loin que les fidèles de la Tradition républicaine ont longtemps été incapables de la comprendre, de la déchiffrer, et même de la voir dans la violence de sa réalité d’attentats, de tortures et de menaces de s’étendre au-delà de la Méditerranée. Successivement regardée comme désordre local, « évènements » à dominer en liant fermeté et réformes socio-économiques, voire comme théâtre de la guerre froide, elle se verra réduite en 1960 par de Gaulle à un épisode naturel de la décolonisation mondiale.
Héritage méconnu d’une Seconde République, brève et constitutionnelle, elle aura vu son destin français scellé autour de l’erreur-source de la départementalisation, que le radicalisme du FLN devenu GPRA, n’aura de cesse de dénoncer, en se proclamant « révolutionnaire » et opposé à toute transaction, à toute politique de promotion ou d’élections, organisées par une administration centrale qui doit être détruite.
Voilà ce que le docteur Mostefaï est venu rappeler, lors d’un débat sans concession avec Antoine Prost qui l’interrogeait précisément sur l’interdiction de vote sous peine de mort. Tout accord militaire local et tout espoir d’une quelconque Troisième force étant voués à l’échec, la guerre d’Algérie, devenue le choc de deux souverainetés, allait durer jusqu’à l’humiliation finale des responsables français et cela, quelle que soit la sincérité d’un de Gaulle qui, non content de ramener les Français, l’armée et l’administration vers les réalités d’un temps qui transforme, dut aussi convaincre de sa bonne foi des alliés ou amis, dont le soutien à l’ONU était indispensable et d’autant que ses adversaires avaient fait de l’ONU le champ de bataille de leurs meilleures victoires…
La guerre d’Algérie fut donc une tragédie humaine, politique, intellectuelle et même spirituelle qui laissa sans voix nombre de responsables, accablés devant un désastre final, maintes fois annoncé. La République en sortit transformée, dotée d’institutions démocratiques qui, deux fois dévoyées par les Bonaparte, auront eu du mal à tracer leur voie contre une Tradition républicaine datant de l’aube du XXe siècle et dont la fierté avait été de voir son régime parlementaire suffisamment établi pour s’imposer contre l’antisémitisme contemporain de l’affaire Dreyfus, en Algérie comme en France, et sur cet élan, d’avoir proclamé l’union nationale et gagné la Grande Guerre, grâce à l’aide des troupes coloniales. Mais le malheur voulut que, épuisé par cet effort, le régime exclusivement parlementaire révéla son insuffisance face à une nouvelle guerre comme face à la décolonisation qui s’ensuivit. Issu d’un passé antérieur, que seule la découverte de ses archives révèlera, de Gaulle assuma, sans excuses ni repentir, conscient du fait qu’il sacrifiait la grandeur d’un passé irréprochable à la possibilité pour le pays de passer ce cap, difficile entre tous, afin que libéré pour la seconde fois, il puisse reprendre son chemin d’avenir.
Mais comme le rappelle Jacques Frémeaux, Français d’Algérie d’une grande finesse, Malraux ne l’avait-il entendu dire qu’ « être grand, signifiait soutenir une grande querelle ? »...
Odile Rudelle |