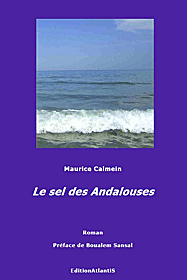Cher Papa,
Je me souviendrai toujours de cette horrible journée du 20 juin 1962.
J’avais 10 ans, tu en avais 40, comme maman. Nous habitions Oran, au quartier Saint Hubert.
Tu es parti en vélo vers 16h30 pour faire quelques courses à l’épicerie Moulay. Je t’avais demandé de me rapporter de la longanisse pour le repas du soir. J’adorais ça et celle de chez Moulay était excellente.
Le quartier était calme comparé à la veille où Maman avait eu très peur des Arabes qui étaient passés dans la rue très nombreux et excités en criant et en brandissant des drapeaux vert et blanc.
J’avais mis mon costume de Davy Crocket que le Père Noël m’avait apporté quelques mois plus tôt et je rampais dans le jardin avec ma carabine à flèches, visant des indiens ou des fellaghas imaginaires.
Maman surveillait mes exploits guerriers par dessus la jardinière de persil de la fenêtre de sa cuisine.
Vers 18 heures, elle m’a demandé de rentrer. Elle avait l’air nerveux. « Il est plus de six heures et Papa n’est pas revenu », me dit-elle, « mets ton gilet et viens avec moi. On va aller chez la voisine, Madame Chénier. Elle a le téléphone ».
Maman a appelé partout, chez Moulay, chez notre cousine Angéline, chez Bakti, le réparateur de vélo, et même chez Gilabert, ton copain garde mobile d’avant les événements avec qui on allait souvent à la pêche le dimanche.
Je commençais à m’inquiéter pour ma longanisse et Maman a éclaté en sanglots dans les bras de Madame Chénier.
A peine avions-nous regagné la maison que cette dernière arriva en courant et en criant que Monsieur Moulay l’avait rappelée pour signaler que ton vélo avait été retrouvé au bord de la route, près du terrain vague bordant l’épicerie. J’imaginais ce vélo rouge avec ses sacoches et son changement de vitesses. Il faisait mon admiration depuis que tu l’avais acheté. J’espérais qu’il ne s’était pas abîmé en tombant.
Plus les heures passaient et plus elles nous confirmaient que tu avais disparu.
Maman n’arrêtait pas de pleurer et je m’y suis mis moi aussi. La nuit qui tombait me fit prendre conscience de ton absence. J’avais froid et peur du moindre bruit venant du dehors.
Maman est encore sortie après m’avoir enfermé à clef. Elle est vite revenue avec Mme Chénier et son mari, puis d’autres personnes sont arrivées et reparties. Il y avait beaucoup d’agitation et je ne comprenais pas tout ce qu’ils disaient. On m’envoya jouer dans ma chambre,… comme si j’avais envie de jouer !
Maman m’a autorisé à dormir dans votre grand lit et tout d’un coup, elle m’a serré très fort contre elle en pleurant.
Malgré toutes les recherches que Maman, les cousins et les amis ont pu faire, nous n’avions aucune nouvelle de toi. Le signalement de ta disparition à ce qui restait de police française n’apporta pas le moindre indice.
Un mois et demi plus tard, le 23 août, nous quittions Oran pour toujours. Avant de monter sur le bateau, je me suis jeté par terre en pleurant et en hurlant que je ne voulais pas partir sans toi. Il faisait chaud, il y avait beaucoup de monde avec des valises et des paquets. Maman s’est évanouie et des gens nous ont donné de l’eau.
J’ai longtemps regardé Oran qui s’éloignait, noyé dans mes larmes. Je voyais ton visage se fondre dans la ville. J’aurais voulu mourir.
En France, il faisait aussi chaud et cela me surprit. Au lieu de verdure, ce furent les collines arides des environs de Marseille qui nous accueillirent. Les premiers jours furent épuisants. Nous avons attendu pendant des heures, parqués comme des bêtes. Nous avons pris plusieurs fois des trains bondés pour des voyages interminables. Et Maman pleurait toujours. Nous avons finalement échoué à Toulouse, chez des gens qui ont été très gentils avec nous. Le Monsieur, André, nous a amenés à la police, puis à la préfecture pour dire, une fois de plus, que tu avais disparu. Je ne comprenais pas tout, mais à un moment, l’employé a dit qu’on ne te reverrait pas. Là, j’ai beaucoup pleuré et je n’arrivais plus à respirer. Les Français de France n’étaient pas toujours très gentils avec nous. Les années ont passé, toujours sans nouvelles de toi.
A l’école, au club de foot, aux scouts, j’ai toujours eu le sentiment de ne pas être comme les autres enfants et il m’est arrivé d’envier ceux qui pouvaient se déclarer clairement « orphelins ». Quand on me posait des questions, je ne savais pas quoi répondre, quelle était ta profession, si Maman était mariée ou non et, parfois, j’avais honte.
Aujourd’hui, j’ai ton âge, celui que tu avais quand tu es parti, et quand on me demande si tu es décédé, je suis toujours obligé d’expliquer assez longuement les choses.
Quand je vois que pour le moindre retard de train on met en place une cellule d’accompagnement psychologique, je me dis que pour nous, on n’a vraiment rien fait.
Je t’ai revu en rêve des centaines de fois. Certaines nuit, je n’ai vu que le vélo rouge renversé dans le terrain vague, avec la roue avant qui continuait de tourner dans le vide, comme ta présence que nous ressentons toujours, proche et lointaine à la fois.
Nous avons tout imaginé de ce qui a pu t’arriver et cette interminable quête, cette incertitude angoissante hantent toujours nos vies.
Pour les autres, tu es un « disparu », appellation administrative bien commode qui leur permet de te ranger dans une de leurs boîtes d’archives.
Nous, nous ne saurons jamais si tu es mort, où et comment, si tu as souffert, ou si tu es toujours de ce monde. Parfois, on a l’impression que tu vas peut-être refaire irruption parmi nous. Et si tu es vivant, comment es-tu ? Que fais-tu ? Où es tu ? Es-tu en prison ? dans un camp de travail forcé ? toujours en Algérie ?
Maman nous a quittés l’année dernière. Ce fut sans doute pour elle une délivrance, une façon de te rejoindre. Elle, au moins, je sais où elle est et pourquoi.
Mon père, lui, est un fantôme qui me hantera et que je pleurerai jusqu’à mon dernier jour. |